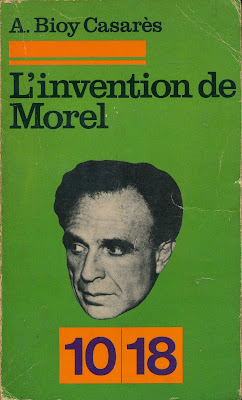Dans son roman « L’Année du lion », paru en France en 2017, l’écrivain sud-africain Deon Meyer avait anticipé l’actuelle épidémie due au coronavirus.
Propos recueillis par Maryline Baumard Publié hier à 09h00, mis à jour hier à 14h21
 |
L’écrivain Deon Meyer, à Stellenbosch,
en Afrique du Sud, le 23 janvier 2020. |
Une voiture abandonnée sur une route déserte, un peu de nourriture périmée. C’est dans cet environnement qu’un père et son fils, tous deux survivants du « viruscorona » qui vient de décimer 95 % de la population mondiale, sont attaqués par des chiens sauvages. Ainsi commence L’Année du lion, un roman de Deon Meyer que la France a pris en 2017 pour un récit postapocalyptique. Personne n’imaginait à l’époque que cette fiction racontait déjà l’actuelle pandémie liée au coronavirus. Pas même son auteur.
L’écrivain sud-africain avait pourtant fait valider scientifiquement que le coronavirus était bien l’agent pathogène le plus dangereux pour la race humaine et la planète. Il avait travaillé sur sa transmission et ses conséquences sur nos sociétés mondialisées, du passage de l’animal à l’homme à la contamination intercontinentale, en passant par la fermeture des frontières ou les détournements de masques de protection, devenus armes de cette drôle de guerre…
Trois ans après la traduction du roman en français, la trame qui le sous-tend, improbable hier pour une imagination moyenne, est devenue réalité. Drôle de préfiguration ! Y compris pour Deon Meyer, qui s’est replongé dans ses notes, lui-même un peu effrayé de découvrir que son roman avait anticipé une catastrophe planétaire.
Une humanité décimée par un coronavirus, c’est le point de départ de L’Année du lion. Comment vous est venue cette idée ?
Pour être honnête, avec L’Année du Lion, je voulais d’abord explorer notre monde après qu’un virus eut décimé la population mondiale, et pas tant la pandémie elle-même. Il se trouve que les récits de l’expérience chaotique des personnages durant la pandémie n’ont cessé de s’inviter dans le livre, ce qui m’a obligé à faire des recherches sur la nature des pandémies et à essayer d’imaginer ce que ce serait de vivre une telle situation.
Pour mettre en scène ce monde fictif postapocalyptique que je voulais, je devais tuer 95 % de la population mondiale, mais laisser toutes les infrastructures intactes. Mes recherches pour le roman ont été faites après l’apparition de la grippe aviaire H5N1 de 1996 et de la grippe porcine H1N1 de 2009-2010. Ces deux crises terrifiantes, ainsi que les épidémies récurrentes d’Ebola en Afrique, m’ont donné l’idée d’explorer la possibilité qu’un virus soit à l’origine de l’apocalypse dont j’avais besoin.
Alors j’ai commencé à chercher un expert de classe mondiale en matière de virus et je suis tombé sur le professeur Wolfgang Preiser, chef du département de virologie médicale de l’université de Stellenbosch.
L’idée vous paraissait-elle farfelue, à l’époque, quand vous l’avez posée comme base de votre roman ?
Plus j’approfondissais mes recherches à l’époque, moins l’idée me semblait farfelue. Beaucoup de gens très intelligents, tous des scientifiques très respectés dans divers domaines, avertissaient qu’une pandémie se préparait et que ce n’était qu’une question de temps avant qu’un virus ou une bactérie ne fasse de vrais ravages. Ce qui m’a fasciné alors, c’est que personne ne semblait les écouter. N’est-ce pas d’ailleurs la même chose avec la montée des superbactéries à cause de l’abus d’antibiotiques ? Ou avec le réchauffement climatique, bien que de plus en plus de dirigeants mondiaux semblent maintenant prendre cette question plus au sérieux ?
Pourquoi un coronavirus, et pas Ebola ou un autre agent pathogène ?
J’avais demandé à Wolfgang Preiser d’identifier un virus qui pourrait tuer 95 % de la population mondiale. Magnanime et indulgent, le professeur a non seulement joué le jeu avec enthousiasme, mais il a aussi fait appel à un illustre collègue à lui, le professeur Richard Tedder, de l’University College de Londres, pour qu’il l’aide. Tous deux ont identifié le coronavirus comme le meilleur candidat, bien qu’ils aient dit que mon chiffre de 95 % était bien trop pessimiste, et m’ont donné tous les détails sur la façon dont cela pourrait se produire. Détails que j’ai inclus dans le roman.
Racontez-nous, pour ceux qui n’ont pas lu le roman, quelques-uns de ces détails de la transmission telle que vous l’aviez décrite…
Eh bien, quelque part en Afrique tropicale, un homme est allongé sous un manguier. Cet homme est affaibli parce qu’il est séropositif et ne bénéficie d’aucun traitement ; en plus, il est porteur d’un coronavirus. Mais rien d’étrange à cela, les coronavirus sont assez courants ; avant la pandémie, on en connaissait au moins quatre qui provoquaient des symptômes de grippe ou des rhumes chez l’humain.
Les coronavirus sont également présents chez les animaux, les mammifères et les oiseaux. Or dans le manguier, il y a une chauve-souris, porteuse d’un autre type de coronavirus. Cet animal malade défèque sur le visage de l’homme allongé. Les excréments liquides entrent en contact avec ses yeux, son nez ou sa bouche, ce qui introduit le second coronavirus dans son système respiratoire, avant que les deux coronavirus se multiplient ensemble à l’intérieur des mêmes cellules de sa trachée. Là, leur matériel génétique se combine, donnant naissance à un nouveau coronavirus, extrêmement pathogène, qui peut facilement infecter d’autres personnes par simple inhalation.
L’homme du manguier vit dans une communauté pauvre, où les gens s’entassent les uns sur les autres et où l’incidence du VIH est élevée. Evidemment, il infecte rapidement d’autres personnes. Et le nouveau virus se répand dans la communauté, en continuant de muter. Et une de ses mutations le rend capable de se transmettre facilement dans l’air et de contaminer des personnes en les laissant asymptomatiques assez longtemps pour qu’elles en infectent beaucoup d’autres avant de mourir.
Un des membres de la famille de l’homme du manguier, touché lui aussi, travaille dans un aéroport de la ville voisine et tousse sur une passagère, juste avant que cette femme ne prenne un vol pour l’Angleterre, où se déroule alors un grand événement sportif international…
Si l’on remplace la chauve-souris par le pangolin, la chaîne de transmission ressemble à ce qu’on a connu…
Dans mon roman, tous les pays développés ont bien sûr un protocole à appliquer en cas de maladie infectieuse mortelle. Comme la plupart des pays en développement, qui ont aussi des plans détaillés pour ce genre de scénario. Il y avait des directives et des systèmes pour contrer une épidémie. En théorie, ils auraient dû fonctionner. Mais la nature n’a pas tenu compte de ces théories. Et la faillibilité humaine non plus…
Tout de même, le fait de vivre sur le continent africain ne rend-il pas un écrivain plus sensible à cette thématique des pandémies ?
Très certainement. Et pas seulement à cause du VIH/sida et du virus Ebola. La pauvreté, la densité de population dans les villes, les systèmes de santé fragiles, la corruption et les dirigeants irresponsables créent des conditions de circulation rapide des virus.
Je dois m’empresser d’ajouter que l’Afrique du Sud a beaucoup de chance d’avoir un dirigeant comme le président Cyril Ramaphosa en ce moment, mais même lui et son gouvernement sont aux prises avec l’horrible héritage de notre ancien président kleptocrate Jacob Zuma et de ses acolytes, qui ont pratiquement détruit notre pays sur le plan économique. Notre capacité à lutter aujourd’hui contre le Covid-19 est d’ailleurs sérieusement entravée par cette situation.
Vous sentez-vous visionnaire ?
Les véritables visionnaires sont les professeurs Preiser et Tedder, et tant d’autres scientifiques qui nous ont mis en garde, mais nous ne les avons pas pris au sérieux. Tout ce que j’ai fait, c’est extrapoler leurs informations et essayer d’imaginer une pandémie et ses conséquences.
Je dois admettre que je ne trouve aucun plaisir à avoir anticipé ce qui est en train de se passer. Les personnes qui ont perdu des proches dans ces circonstances très difficiles souffrent terriblement. Personnellement, ma fille vit en Italie – j’ai le bonheur qu’elle soit en bonne santé –, ma mère a presque 90 ans, et moi, j’en ai quasiment 62. Ajoutons que j’ai fumé pendant une grande partie de ma vie. Donc j’ai un peu de souci à me faire…
Depuis L’Année du lion, vous êtes passé à autre chose, vous avez écrit d’autres livres. A quel moment de l’apparition de cette pandémie ce souvenir a-t-il refait surface ?
Le souvenir de ce roman m’est revenu tout à coup alors que, à la mi-janvier, le virus se répandait très rapidement à Wuhan et qu’on a commencé à en parler par-delà les frontières chinoises. L’affaire a vite pris un tour tel que j’ai remis le nez dans mes notes de recherche de 2015-2016 pour l’écriture de L’Année du lion. Et je me suis fait peur…
On dit que la politique, c’est l’art de prévoir… Cette crise ne montre-t-elle pas que les gouvernants manquent cruellement d’imagination pour dessiner leur champ de prévisions ?
Les grands dirigeants ne manquent pas d’imagination. A leur décharge, ils ont peut-être eu tellement de sujets à gérer ces dernières années – l’économie mondiale, la crise des réfugiés, le terrorisme, le Brexit, un imbécile à la Maison Blanche, la montée des extrêmes droites et des nationalismes, la menace croissante du réchauffement climatique – qu’ils n’ont tout simplement pas eu le loisir nécessaire pour s’inquiéter des pandémies virales. Ni l’argent nécessaire pour s’y préparer, d’ailleurs.
Pour moi, nous vivons dans un monde divisé et largement débordé par ses problèmes écologiques, économiques et politiques. Même les très grands hommes politiques n’ont ni les moyens ni le soutien nécessaire pour faire tout simplement ce qu’il faudrait. En tant qu’électeurs, nous devons également en assumer la responsabilité. Si nous ne commençons pas à nous unir derrière les dirigeants qui veulent penser un monde durable, nos enfants en paieront le prix.
Ne considérez-vous pas aujourd’hui que la littérature s’impose comme un meilleur moyen d’anticiper l’avenir, plus efficace que la politique ?
Oui, je crois que la littérature est la meilleure façon d’anticiper l’avenir. Elle l’a toujours été, mais, pour être juste, il faut dire que la littérature s’est aussi beaucoup trompée. D’ailleurs, si la littérature permet de mieux anticiper, c’est peut-être parce que les auteurs ont le luxe de spéculer sans conséquences.
L’Année du lion, de Deon Meyer, traduit de l’afrikaans et de l’anglais par Catherine Du Toit et Marie-Caroline Aubert, éd. Seuil, 2017, 640 pages, 23 euros.